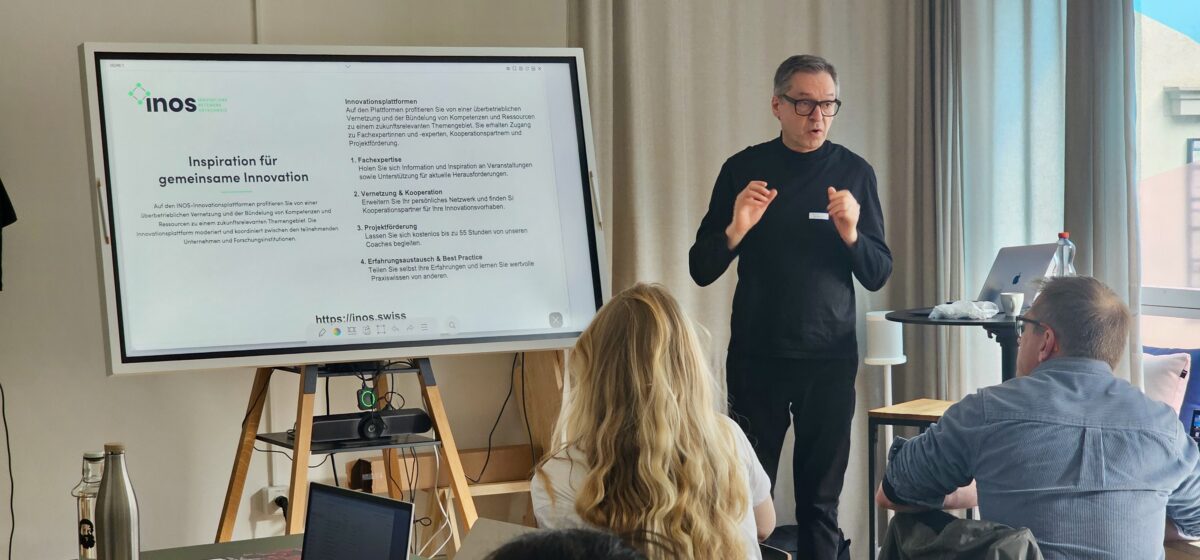Le cours d’introduction à la Nouvelle politique régionale est déjà un classique – et il affiche généralement très vite complet. À qui ce cours est-il utile et qu’en disent les participantes et participants? Nous avons interrogé les personnes présentes au cours d’une journée à Altdorf, dans le canton d’Uri.
La Nouvelle politique régionale (NPR) est un excellent instrument permettant à la Confédération de promouvoir l’innovation, la création de valeur locale et la création d’emplois. Mais elle est complexe: sa mise en œuvre se fait dans 26 cantons, chacun avec ses propres programmes et conditions-cadres. En outre, il existe une multitude d’acteurs locaux, régionaux et même internationaux.
Le cours d’introduction permet d’y voir plus clair. C’est ce que confirme Rolf Infanger, participant de l’association des communes d’Uri: «Je suis venu dans l’espoir d’apprendre les principes fondamentaux de la Nouvelle politique régionale et de découvrir comment, en tant que manager régional, je pouvais aider au mieux mes clientes et clients. Mes attentes ont été pleinement comblées!»
Marcel Zumkemi, du Centre régional et économique du Haut-Valais (RWO), recommande même le cours d’introduction à toutes les personnes en contact avec la Nouvelle politique régionale: «Il fournit des informations de fond précieuses. Même si l’on a déjà travaillé sur plusieurs projets NPR, le cours est utile.»
Idées pour l’organisation et le conseil
Nadia Scherer, de la destination Einsiedeln-Ybrig-Zürichsee, est confrontée presque quotidiennement à la complexité de la NPR: «Dans notre région touristique, nous avons travaillons souvent avec plusieurs cantons, ce qui rend notre travail exigeant. J’ai été soulagée d’apprendre lors du cours d’introduction que je n’étais pas la seule à trouver cette situation exigeante, mais que cela était dû au système de la NPR. Je retire de ce cours de nouvelles idées sur la manière dont nous pouvons mieux répondre à ce système.»
Le contenu du cours d’introduction est axé sur la pratique. Jasmin Schlaepfer, de VISIT Glarnerland, partage cet avis: «J’ai beaucoup apprécié la combinaison d’exemples pratiques et de théorie. Et je me sens bien accompagnée, car je sais désormais où trouver des connaissances complémentaires. En tant que responsables du développement de la destination, nous accompagnons les projets dès la base. Grâce au cours d’initiation, j’ai gagné en assurance dans le domaine du conseil et je peux désormais encore mieux soutenir les initiatrices et initiateurs de projets.»

Élargissement des horizons grâce à une formation présentielle
Après avoir été proposé plusieurs fois en ligne, le cours d’introduction s’est cette fois-ci déroulé en présentiel, à l’Innovationsbiotop Uri à Altdorf, ce qui lui a conféré une dimension particulière: les participantes et participants ont assisté à la présentation de l’exemple pratique du Saint-Gothard avec vue sur les montagnes fraîchement enneigées du canton d’Uri. David Kramer, du SECO (co-responsable du secteur Politique régionale et Aménagement du territoire), s’est également tenu à disposition pendant les pauses pour des discussions spontanées. Pour Marcel Zumkemi, le déplacement depuis le Haut-Valais en valait la peine: «Outre tous les contenus et les liens intéressants reçus lors du cours d’introduction, j’ai trouvé les échanges avec mes collègues du développement régional extrêmement précieux.»
Informations complémentaires sur le cours d’introduction
Les cours d’introduction sont annoncés dans l’agenda de regiosuisse.
Prochaines dates:
- Jeudi 5 mars 2026 à Willisau (DE), COMPLET – Annonce
- Jeudi 16 septembre 2026 à Diemtigen (Wiriehorn) (DE), Annonce suit
- Jeudi 26 novembre 2026 à Lausanne (FR) – Annonce
Liens utiles issus du cours d’introduction
- Vidéo explicative sur la Nouvelle politique régionale
- Guide pratique pour un développement régional réussi
- Aperçu des aides financières dans le développement régional
- Base de données de projets (une vue d’ensemble unique en Suisse des projets de développement régional)
- regios.ch (blog avec les meilleures pratiques)