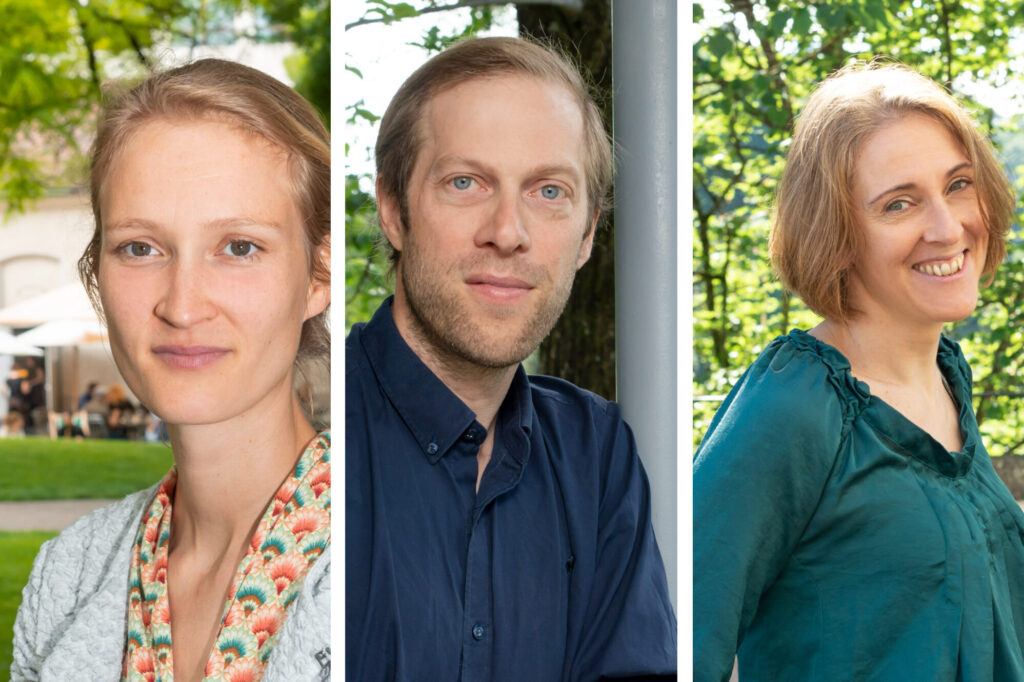Sommaire
- Un bleu comme point de départ
- Les moteurs de cette évolution
- Projet à long terme de «marque faîtière régionale»
- Caractéristiques de l’OQuaDu et de la NPR
- Subventions pour la transformation et la commercialisation
- Presque tout serait possible avec le bois
- Regard vers l’avenir
- Qu’est-ce qui est vraiment régional?
- ProSpecieRara: une pionnière
- Efforts de coordination
- Clarifications nécessaires


La laitue pommée du magasin Migros de Lucerne est fraîche comme une rose. Son étiquette révèle qu’elle a été cueillie aux portes de la ville. Ce légume à feuilles est l’un des quelque 18’500 produits régionaux certifiés actuellement en vente dans le commerce de détail alimentaire et sur les marchés de toute la Suisse. Ce segment est en plein boom. Les ventes de ce secteur ont augmenté de 10% par année entre 2015 et 2020 selon l’étude Produits régionaux 2022 de htp St-Gall (spin-off de l’Université de St-Gall) et de l’Institut d’études de marché LINK en collaboration avec la Haute école d’économie de Zurich (HWZ). Le chiffre d’affaires réalisé avec ces produits a probablement dépassé le seuil de 2,5 milliards de francs. «Les produits régionaux sont le secteur à plus forte croissance du domaine alimentaire», déclare Stephan Feige, coauteur de l’étude et chef du département de la HWZ Gestion authentique des marques. Cette croissance rapide reflète le succès de la stratégie de marketing des grands distributeurs Migros et Coop. Mais elle se fonde également sur l’engagement de milliers de paysannes et de paysans qui assurent le ravitaillement nécessaire au niveau de la production. «Il y a longtemps que les produits régionaux ne sont plus une niche. Du Jura au Tessin en passant par les Alpes, ou du lac de Constance au Léman, il y a partout des success stories», affirme Gabi Dörig-Eschler, directrice de l’Association suisse des produits régionaux (ASPR). Les quelque 2800 productrices et producteurs qui misent sur la marque regio.garantie de l’ASPR pour distinguer leur assortiment comme produits régionaux réalisent un chiffre d’affaires de 1,7 milliard de francs par année.
Un bleu comme point de départ
Le label Appellation d’origine contrôlée (AOC) ou protégée (AOP, depuis 2011) est considéré comme le précurseur en faveur des produits régionaux. Ce label, qui atteste l’origine géographique de certaines spécialités, a une longue histoire derrière lui. Déjà au XVe siècle, les habitantes et les habitants de Roquefort (France) ont obtenu un monopole royal pour la fabrication du bleu légendaire du Massif central. Ce produit a été protégé par décret en 1925. De nombreux pays européens appliquent maintenant le modèle français pour leurs spécialités régionales les plus célèbres. Ils les caractérisent soit par le label de qualité AOP, soit par l’IGP (Indication géographique protégée).
La coopérative Migros Lucerne a lancé en 1999 son propre programme régional avec «De la région, pour la région». D’autres coopératives Migros n’ont pas tardé à reprendre ce concept. Volg a suivi en 2005 avec «Délices du village» et Coop en 2014 avec «Ma région». Ensuite, Landi a pris le train en marche en 2016 avec «Naturellement de la ferme», Aldi en été 2022 avec «Saveurs suisses » et Lidl Suisse peu après avec «Typiquement». Plus aucun commerçant ne peut se permettre aujourd’hui de se tenir à l’écart des produits régionaux.
Les moteurs de cette évolution
Ce boom repose sur plusieurs facteurs. Voici l’explication de Stephan Feige: «La régionalité est à la mode au sein d’une partie rapidement croissante de la population. Une des raisons de cette tendance est la recherche d’authenticité et d’origine précise, aussi en réaction à la globalisation.» Les consommatrices et les consommateurs associent aux produits régionaux les valeurs de qualité et d’identité, mais aussi de durabilité écologique et sociale. Selon l’étude de la HWZ, ce sont surtout les femmes qui leur associent des caractéristiques supplémentaires telles que valeur ajoutée sociale, équité et bien-être animal. Un argument supplémentaire est la traçabilité des produits qui crée de la confiance grâce à la transparence et à la proximité avec le producteur. La boucherie Meaty, Genève et Lausanne, vend par exemple exclusivement de la viande provenant d’exploitations agricoles des environs. Le plus souvent urbaine, la clientèle peut s’informer sur l’élevage des animaux jusqu’au moindre détail via un site Internet. La régionalité rencontre une forte disposition à payer chez les consommatrices et les consommateurs. Selon l’étude de la HWZ, ils sont prêts à payer 45% de plus pour des œufs qui viennent de poules de la région. Les légumes régionaux peuvent coûter 30% plus cher, les fromages à pâte dure 20%.
Il n’est pas possible de raconter la success story des produits régionaux sans mentionner les nombreux autres acteurs de la chaîne de création de valeur ajoutée. Non seulement quelques organisations à but non lucratif, mais aussi différents programmes de promotion de la Confédération apportent un soutien décisif. L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) joue un rôle de leader. Il soutient des projets de développement régional (PDR) dans lesquels l’agriculture prend une part déterminante. Il promeut en outre la qualité et la durabilité dans le cadre d’une ordonnance conçue à cet effet (OQuaDu). L’OFAG soutient aussi des projets par le biais du Plan d’action national pour la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (PAN-RPGAA), lancé en 1999. Il promeut enfin la conservation des ressources zoogénétiques – un programme actuel de survie pour 25 races anciennes d’animaux de rente. La promotion des produits régionaux est aussi un thème prioritaire du Secrétariat d’État à l’économie (SECO), en collaboration avec les cantons, dans le cadre de la Nouvelle politique régionale (NPR) et par le biais du programme de promotion touristique Innotour. Enfin, la Confédération vise aussi à renforcer les produits régionaux avec le label «produits» de la politique des parcs ainsi qu’avec différents projets-modèles pour un développement territorial durable. Étant donné que la création de valeur ajoutée régionale est au centre d’un bon nombre de ces programmes, les cantons cofinancent un grand nombre de ces projets à titre subsidiaire.

Projet à long terme de «marque faîtière régionale»
Depuis leur lancement, plus de mille projets ont pu bénéficier des programmes de soutien: environ 600 projets RPGAA, 200 projets NPR, plus de 100 projets PDR et OQuaDu ainsi que quelques projets Innotour et quelques projets-modèles pour un développement territorial durable. Les chiffres ne révèlent certes pas grand-chose de la qualité et de l’importance des différents projets, mais un projet soutenu par des fonds publics est dans de nombreux cas décisif pour le succès ultérieur. C’est par exemple le cas de la création d’un label régional pour le Grand Entremont en Valais: ce PDR comprend non seulement des mesures de marketing, mais aussi des investissements dans la production et la transformation de lait, de viande, de fines herbes et de miel. La gamme traditionnelle des produits de l’économie laitière régionale, avec le fromage à raclette Valais AOP, est développée et complétée par de nouvelles offres agrotouristiques. La Confédération à elle seule participe à raison de 5 millions de francs à ce projet dont la durée prévue est de six ans et le budget de 12,5 millions.
Des PDR similaires sont en cours dans d’autres régions de montagne – dans la région Loèche-Rarogne, dans le Parc naturel Beverin, dans la réserve de biosphère UNESCO de l’Entlebuch ou dans le val Poschiavo. Le point commun à tous ces PDR est une stratégie globale mise en œuvre par le biais d’un ensemble de mesures. De plus en plus souvent, celles-ci tiennent également compte de critères écologiques, comme c’est le cas du PDR «100% bio» mené dans le val Poschiavo.
Caractéristiques de l’OQuaDu et de la NPR
De temps en temps, les contenus des différents programmes de soutien peut se chevaucher. Chaque ensemble d’instruments a néanmoins son caractère unique. L’OQuaDu par exemple vise de meilleures normes de production et de qualité. Les projets correspondants sont soutenus à tous les niveaux de la chaîne concernée de création de valeur ajoutée. Certaines conditions à remplir sont d’avoir un caractère exemplaire pour toute la branche, d’améliorer les opportunités commerciales pour l’agriculture et les branches situées en aval et d’accroître la création de valeur ajoutée agricole dans la région. De nombreux produits innovants du secteur agroalimentaire doivent leur (re)naissance à l’aide initiale venant de l’OQuaDu, par exemple: soja bio, lait bio de pâturages, produits aux orties, viande de poules suisses, quinoa, truffe ou baies sauvages. Il y a en outre des projets OQuaDu axés sur les infrastructures ou la diffusion de technologies durables, par exemple l’usage de rayons UV-C pour lutter contre les champignons dans les vignes et les cultures de petits fruits.
La NPR se concentre surtout sur des mesures préconcurrentielles qui génèrent de la valeur ajoutée dans une région. Les projets phares sont les projets de mise en réseau d’acteurs, le plus souvent mis en œuvre dans le cadre d’une stratégie globale, par exemple la «Promotion des produits régionaux de l’Oberland bernois» (début du projet en 2017) ou la «Chaîne de création de valeur ajoutée des produits régionaux natürli» (2020, ZH et TG). La plateforme «food & nutrition» est également issue d’un projet NPR. Elle met en réseau toutes les personnes du canton de Fribourg qui s’intéressent à la production et à la transformation d’aliments durables. L’association responsable a aussi pour but de mettre en œuvre la stratégie alimentaire circulaire que le canton a adoptée en 2021.
Subventions pour la transformation et la commercialisation
Les programmes de soutien se concentrent sur l’agriculture, avec les domaines situés en aval. Les besoins d’investissement paraissent particulièrement importants dans le domaine de la transformation. C’est ce que révèlent des projets comme la construction des abattoirs régionaux de Klosters-Serneus ou la nouvelle installation de production de sérac de Glarner Milch AG. Cette dernière installation, un projet à 10 millions de francs achevé en 2017, comprend notamment une cave d’affinage et une fromagerie de démonstration. La Confédération a soutenu ce projet dans le cadre d’un PDR à raison de 2,17 millions de francs.
Un thème fréquent de nombreux projets est la commercialisation. Ils concernent aussi bien de nouveaux canaux numériques de promotion et de commercialisation que de la relance de canaux traditionnels. Le projet NPR «Konzept Hofladen Willisau» a été lancé en 2022. Le projet OQuaDu «Alpomat – le plus petit magasin de ferme de la ville de Zurich» a démarré en 2017. La Poste promeut aussi les canaux de distribution régionaux – numériquement et physiquement: la plateforme «Local only» permet aux productrices et aux producteurs de vendre leurs produits régionaux en ligne. La Poste prend en charge la logistique – sans courses supplémentaires puisqu’elle apporte la marchandise commandée à la porte des clients avec le courrier normal.
Presque tout serait possible avec le bois
Un fort potentiel régional sommeille dans la chaîne de création de valeur ajoutée du bois. Au cours des dernières années, plusieurs cantons ont lancé leurs propres programmes de promotion, à l’instigation notamment de la NPR et du plan d’action bois de la Confédération. Celui-ci soutient depuis 2009 des projets qui traitent de cette matière première et de sa valorisation. Un des résultats actuels de ces efforts est la Communauté d’intérêts Truberwald, fondée par des propriétaires forestiers, des agriculteurs, des forestiers-bûcherons, des charpentiers et des menuisiers, qui ont réalisé un projet phare en 2022 avec la salle de gymnastique de Trub (BE). Cette construction est fabriquée exclusivement en bois de la forêt de Trub. «Chaque baguette, chaque lambourde, même le plafond acoustique: tout est en bois régional», confie Samuel Zaugg, forestier-bûcheron et cofondateur de la CI Truberwald. Celle-ci a joué le rôle de plaque tournante de l’approvisionnement en bois. Les expériences issues de la construction de la salle de gymnastique sont maintenant intégrées dans le modèle commercial proprement dit de la CI, qui consiste à communiquer aux maîtres d’ouvrage intéressés toutes les informations logistiques et organisationnelles sur la construction avec du bois régional ou avec leur propre bois. Le véritable défi consiste à amener les consommatrices et les consommateurs à exiger systématiquement du bois suisse, souligne Samuel Zaugg, car « avec du bois, presque tout est possible aujourd’hui dans la construction ».
Le potentiel de coopération régionale entre l’agriculture et le tourisme est aussi resté longtemps inexploité. Mais pas mal de choses se sont mises en mouvement au cours des dernières années. Le programme «Genuss aus Stadt und Land» est un PDR stratégique qui a pour but, depuis 2017, de développer dans l’agglomération de Bâle de nouvelles formes de production régionale et de coopération entre agriculture, restauration, hôtellerie et détaillants. Dans la région Bienne-Seeland, un projet NPR, lancé en 2020 avec Morat Tourisme comme partenaire, allie «expériences touristiques et gastronomie régionale». L’OFAG et le SECO ont décerné pour la première fois fin 2022 le prix «Cercle régional» à la région du Jura pour ses efforts visant à mettre en place des chaînes régionales de création de valeur ajoutée à l’aide de fonds des politiques agricole, régionale et touristique.

Il ne faut pas oublier non plus le partenariat en cours depuis environ dix ans entre le Réseau des parcs suisses et Coop. La combinaison de tourisme doux, de nature et d’agriculture extensive est bien accueillie par les consommatrices et les consommateurs. Dans ses différentes régions de vente, Coop écoule chaque année davantage de spécialités des parcs régionaux.
Regard vers l’avenir
Si on veut que le boom des produits régionaux se poursuive, des efforts supplémentaires sont nécessaires à tous les niveaux de la chaîne de création de valeur ajoutée. «Il est également clair que, pour les clientes et les clients, l’achat de produits régionaux au magasin doit devenir encore plus simple à l’avenir», Stephan Feige en est convaincu. Il y voit une marge de manœuvre considérable surtout pour les petits commerces spécialisés.
Au-delà de la gamme de produits et d’offres, les critères de la durabilité sociale et écologique, de l’économie circulaire et de la biodiversité gagnent en principe de plus en plus d’importance. «Les consommatrices et les consommateurs ne regardent pas seulement l’origine régionale. Ils tiennent également beaucoup au bien-être animal, à la diversité des espèces et à l’environnement», selon Stephan Feige. Il est prévu que les programmes de soutien attachent eux aussi encore plus d’importance à ces aspects à l’avenir. C’est ainsi que la prochaine période de programmation, NPR 24+, intégrera par exemple davantage la durabilité et l’économie circulaire.
Le renforcement des circuits courts d’approvisionnement pour un système alimentaire résilient reste un élément important de l’orientation future de la politique agricole. Des systèmes alimentaires régionaux durables, de la production à la consommation, peuvent faire progresser durablement la sécurité alimentaire à long terme de la Suisse. En tant que «laboratoires de l’avenir», les régions peuvent jouer un rôle important pour un futur système alimentaire durable.
Qu’est-ce qui est vraiment régional?
aop-igp.ch prospecierara.ch schweizerregionalprodukte.ch
La «région» n’est pas une notion clairement définie, ni politiquement ni géographiquement. Par conséquent, les détaillants essaient de positionner leurs produits régionaux respectifs sur le marché avec leurs propres labels et selon leurs propres critères. Diverses organisations s’efforcent d’éclaircir cette jungle des labels régionaux à l’aide de directives uniformes et de faciliter l’orientation des consommatrices et des consommateurs.
Pirmin Schilliger Luzern
L’Association suisse des AOP-IGP défend les intérêts de toutes les organisations professionnelles qui commercialisent des produits régionaux sous ces labels. La différence entre les deux : pour les spécialités AOP, tout – de la matière première au produit fini en passant par la transformation – doit provenir de la région d’origine définie ; en revanche, il suffit que les spécialités IGP aient été soit produites, soit transformées, soit affinées dans la région d’origine. La liste officielle de la Suisse comprend actuellement 25 produits AOP et 16 spécialités IGP, dont de nombreuses variétés de fromages, des spécialités de saucisses et quelques eaux-de-vie de fruits, mais aussi le pain de seigle valaisan ou la tourte au kirsch de Zoug. La Suisse est affiliée au système AOP-IGP européen dans le cadre de l’accord bilatéral sur l’agriculture conclu avec l’UE. La liste de quelques centaines de produits protégés reconnus par les deux parties est régulièrement actualisée. Les tout derniers produits enregistrés pour le label de qualité AOP sont le boutefas (saucisse de porc) et le «jambon de la Borne» des cantons de Vaud et de Fribourg ainsi que l’huile de noix vaudoise. L’organe responsable de l’admission en Suisse est l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), qui coordonne aussi le registre avec l’UE.
ProSpecieRara: une pionnière
La Fondation ProSpecieRara (PSR), qui célèbre justement son 40e anniversaire, fait partie des véritables pionnières régionales de Suisse. Son principal mérite est d’avoir permis de sauver de la disparition 38 races rares suisses d’animaux de rente – de la poule appenzelloise huppée à la chèvre bottée – et environ 4800 variétés de plantes utiles et ornementales. PSR collabore avec un grand nombre d’agricultrices et d’agriculteurs, avec l’OFAG, la Haute école zurichoise de sciences appliquées, Wädenswil (ZHAW), des organisations d’utilité publique et le commerce de détail. PSR fait en outre office d’interface avec la SAVE Foundation, qui s’engage en faveur de la préservation de la biodiversité à l’échelle européenne.
La chaîne de création de valeur ajoutée «viande de cabri bio Pro Montagna» est un exemple d’utilisation commerciale réussie de «essources zoogénétiques animales». Ses participants sont des paysans de montagne grisons, la Fédération suisse d’élevage caprin, la boucherie Zanetti de Poschiavo (GR) et Coop. Un autre projet de PSR avec Coop comme partenaire porte le nom de «Simmentaler Original». Résultat de la coopération avec PSR: plus de cent variétés traditionnelles de plantes cultivées menacées de disparition se trouvent dans les rayons de Coop, par exemple une variété de panais, un légume très répandu en Europe centrale. La plateforme tomates-urbaines permet également aux jardinières amatrices et aux jardiniers amateurs d’acheter chez Coop des graines de tomates, de piments et de salades rares et de les faire pousser sur leur propre balcon.
Efforts de coordination
Les principaux membres de l’Association suisse des produits régionaux (ASPR), créée en 2015, sont les quatre organisations de commercialisation alpinavera (avec des produits régionaux des cantons des GR, d’UR, de GL et du TI), Culinarium (Suisse orientale), Les délices de la région (Suisse centrale et du Nord-Ouest, JU, BE, SO) et regio.garantie Romandie (Suisse romande et Jura bernois). En qualité d’organisation faîtière, l’ASPR représente plus de 18 500 produits régionaux de toute la Suisse qui portent le label regio.garantie. L’ASPR se concentre sur des standards de qualité uniformes définis selon des directives claires et assure une mise en œuvre impeccable. Suivant ces règles, au moins deux tiers de la création de valeur ajoutée ainsi que les étapes de production et de transformation qui déterminent les caractéristiques du produit doivent notamment avoir lieu dans la région concernée.
Malgré tous les efforts de coordination de l’ASPR, il existe toujours plusieurs labels qui caractérisent la régionalité: Migros le fait avec sa propre étiquette régionale, qui mentionne souvent aussi le nom de la productrice ou du producteur ; Coop en revanche n’appose généralement son label régional que sur les rayons, tout en affirmant que «tous les ingrédients agricoles régionaux et tous les produits doivent être traçables jusqu’au lieu d’origine».
Selon l’étude Produits régionaux 2022 de la Haute école d’économie de Zurich (HWZ), les consommatrices et consommateurs souhaitent en tout cas savoir de quelle région proviennent les matières premières, où elles sont transformées et quel trajet elles ont parcouru. «Or tout cela n’est de loin pas toujours clair avec les labels actuels», constate Stephan Feige, coauteur de l’étude. Dans la pratique, les détaillants définissent à leur guise des critères importants, tels que le périmètre régional. Ils espèrent la confiance de leurs clientes et clients, non sans raison. «Si l’emballage porte la mention ‹ régional ›, la clientèle s’y fie en général», estime Stephan Feige. Personne ne souhaite en outre devoir se débattre devant les rayons avec des directives de plusieurs pages sur chaque label.


Clarifications nécessaires
Conclusion: Le dénominateur commun des marques régionales se limite au fait que la marchandise à vendre peut-être associée à une région donnée. Mais les prescriptions et les critères plus précis selon lesquels se fait cette attribution diffèrent d’un label à l’autre. La définition de la région elle-même reste extensible: c’est ainsi que le règlement Coop de «Ma région» complique sa formulation: «Une région est un territoire géographiquement défini, de dimension moyenne, c’est-à-dire entre le niveau local ou communal et le niveau national, considéré comme homogène et que l’on peut donc différencier d’autres territoires en fonction de caractéristiques données.» Caspar Frey, le porte-parole de Coop, essaie de montrer clairement que Coop suit les directives de l’ASPR en ce qui concerne la création de valeur ajoutée et les étapes de production et de transformation. Cette remarque est aussi valable pour Migros, bien que ces dispositions «limitent parfois beaucoup la disponibilité des produits régionaux au quotidien», selon sa porte-parole Carmen Hefti.
Stephan Feige explique: «Il y a la notion «régional», synonyme de «qui est d’ici»: dans ce cas, le consommateur veut aller chez le producteur du coin. Mais il existe également des produits régionaux comme le saucisson vaudois ou les Läckerlis de Bâle qui sont perçus comme des spécialités régionales célèbres non seulement sur place, mais aussi dans tout le reste de la Suisse.» Une définition standard de la régionalité sous un label unique ne tiendrait guère compte de ce genre de différences et du caractère des divers produits, fait encore remarquer Stephan Feige. Il serait donc peu judicieux, pour des produits transformés tels que le vin, le fromage à pâte dure, les biscuits ou une saucisse fumée connue bien au-delà de sa région d’origine, d’appliquer les mêmes critères régionaux que pour des légumes frais ou des œufs des environs immédiats.
Il n’est pas étonnant que l’on n’ait pas réussi à ce jour à éliminer ce dilemme de définition, bien qu’il désoriente passablement les consommatrices et les consommateurs. «Tout le monde doit être prêt à se conformer à un ensemble de règles nationales et uniformes», souligne Gabi Dörig-Eschler, directrice de l’ASPR, en ajoutant que «la crédibilité de notre réglementation est la base essentielle du succès».