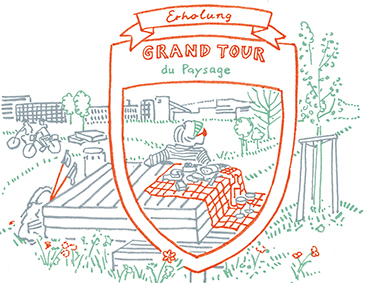Le tourisme d’hiver est pourtant vital pour de nombreuses destinations touristiques. Il faut donc s’attendre, avec le changement climatique, à des saisons hivernales plus courtes dans de nombreux endroits, et ce même si l’on recourt à l’enneigement artificiel. Un certain nombre de projets en cours, soutenus par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) dans le cadre des instruments de promotion que sont la Nouvelle politique régionale (NPR), Interreg et Innotour, aident les destinations à s’adapter au changement climatique.
L’image est éloquente: des prairies vert-brun entourées d’un ruban blanc. Un spectacle auquel de nombreux domaines skiables, en particulier de moyenne et basse altitude, ont dû s’habituer ces dernières années. La durée d’enneigement a diminué de moitié depuis 1970 en dessous de 800 m et de 20% à 2000 m. Le bilan des effets du changement climatique sur l’enneigement en Suisse est donc pour le moins désolant. Si l’on en croit les différents scénarios climatiques de MétéoSuisse, cette évolution se poursuivra dans les années et les décennies à venir. Autrement dit, exploiter de manière rentable des domaines skiables situés en dessous de 1500 m environ sera de plus en plus difficile (Remontées Mécaniques Suisses, 2024). Une situation qui s’explique non seulement par une limite des chutes de neige toujours plus élevée, mais aussi par la diminution du nombre de jours suffisamment froids durant lesquels on peut envisager un enneigement artificiel. À Engelberg, par exemple, à 1037 m d’altitude, le nombre de jours de gel (où la température maximale est inférieure à 0 °C) a presque diminué de moitié depuis les années 1970: d’un peu plus de 40 jours elle est en effet passée à un peu plus de 20 jours (MétéoSuisse, 2024). Une telle situation ne s’explique toutefois pas uniquement par les changements climatiques, la concurrence internationale croissante et l’évolution démographique faisant également partie de l’équation. C’est ainsi que l’on a constaté dans l’ensemble une baisse de plus de 30 % du nombre de journées-skieurs dans les stations de ski suisses depuis le début des années 1990 (Remontées Mécaniques Suisses, 2024c).
Les projets présentés ci-dessous montrent comment les destinations touristiques peuvent faire face au manque de neige et présentent des solutions possibles, ainsi que les opportunités et les risques qui en découlent.
Projet Innotour «Boussole pour les sports de neige»: garantir l’enneigement malgré un climat qui se réchauffe
Remontées Mécaniques Suisses a lancé le projet «Boussole pour les sports de neige» en collaboration avec l’Association suisse des managers en tourisme (ASMT), projet soutenu par Innotour et qui a pour objectif d’aider les destinations touristiques à faire face aux changements des conditions d’enneigement. Il s’agit de développer dans ce cadre un outil permettant aux régions de sports d’hiver de notre pays d’évaluer leur enneigement actuel et futur et de définir les mesures qui s’imposent, ce sur la base des données et des projections climatiques actuelles et en collaboration avec l’ETH Zurich et l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF). Les mesures envisageables comprennent également l’optimisation de l’offre de sports d’hiver, notamment via le recours à l’enneigement artificiel et l’adaptation de la durée de la saison, mais aussi des offres qui ne dépendent pas de l’enneigement, comme la culture et la gastronomie. Une fiche d’information sur les scénarios climatiques pour l’hiver 2050 est d’ores et déjà disponible (Remontées Mécaniques Suisses, 2024). Le projet «Boussole pour les sports de neige» couvre la période 2024 – 2026; d’autres résultats publics sont attendus pour l’été 2025 (Remontées Mécaniques Suisses, 2024b).
Projet Interreg «BeyondSnow»: pour sortir du tourisme hivernal classique
De nombreuses stations de sports d’hiver situées en dessous de 1500 mètres d’altitude devront revoir leur stratégie pour devenir moins dépendantes des activités hivernales classiques. Le projet Interreg «BeyondSnow» (2022-2025, financé dans le cadre de la Nouvelle politique régionale (NPR)) soutient dans cette transition neuf destinations dans six pays alpins fortement touchés par le manque de neige. Le domaine de Sattel-Hochstuckli, dans le canton de Schwyz, fait office de destination pilote pour la Suisse. La situation financière difficile que cette dernière connaît l’a contrainte de fermer deux des trois téléskis en 2023. «Cette issue est évidemment très triste», déclare Peter Niederer, vice-directeur du Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB), également à l’origine du projet. «Sattel-Hochstuckli est l’un des plus anciens domaines skiables des Préalpes et le ski fait partie intégrante de son histoire.» Les acteurs locaux sont systématiquement impliqués dans «BeyondSnow». C’est ainsi que la population locale a participé à l’élaboration de 22 mesures pour assurer la pérennité de la destination. L’accent est mis sur le tourisme 4 saisons, les investissements dans des événements et des coopérations, ainsi que la réduction des coûts fixes. L’infrastructure de ski doit quant à elle pouvoir être utilisée de manière flexible lorsque les conditions d’enneigement le permettent. Les stations de ski qui participent au projet peuvent également profiter d’échanger leurs expériences en la matière. Sattel-Hochstuckli envisage par exemple d’organiser un événement Ultra Trail, inspiré par Métabief, une autre station de ski du Jura français qui participe elle aussi à «BeyondSnow». À l’avenir, un outil numérique d’aide à la décision accessible au public devrait également être développé pour aider d’autres destinations touristiques à anticiper l’évolution de l’enneigement et à s’y adapter en misant sur la réorientation et la diversification (SAB, 2024).

Projet Interreg: «TransStat»: vers un tourisme de ski durable pour les Alpes de demain
Le projet Interreg «TransStat» (2022-2025), auquel participe neuf destinations alpines dans cinq pays, poursuit un objectif similaire à celui de «BeyondSnow». Il s’agit dans ce cas de tester, avec ces destinations et en collaboration avec les acteurs locaux, une procédure afin de développer des scénarios d’avenir souhaitables pour un tourisme (de ski) durable et viable. Ces scénarios doivent servir de base au processus de transition qu’entendent engager les destinations concernées. TranStat développe à cette fin un réseau physique et numérique de sites confrontés à ce type de changement afin de partager des connaissances et des expériences spécifiques. Formuler des recommandations politiques pour l’ensemble de l’espace alpin et pour les contextes régionaux fait également partie des objectifs de ce projet.
Projet Innotour «Destinations climatiquement neutres»: pour une approche globale
Les destinations de montagne sont touchées par de nombreux autres changements induits par le réchauffement climatique. Le projet «Destinations climatiquement neutres» (2024-2026), parrainé par Graubünden Ferien et financé par Innotour, a donc opté pour une approche globale. «Nous voulons que nos destinations relèvent de manière proactive les défis liés au changement climatique et se positionnent en conséquence pour l’avenir», déclare Martina Hollenstein Stadler, responsable du développement durable chez Graubünden Ferien. «Il ne s’agit pas uniquement du thème omniprésent qu’est l’enneigement, mais aussi des autres opportunités et risques que le changement climatique ne manque pas d’entraîner». C’est ainsi que, les étés devenant de plus en plus chauds dans les villes et les agglomérations du Plateau suisse, les touristes en quête de fraîcheur devraient être de plus en plus nombreux à rallier les destinations de montagne (Serquet & Rebetez, 2011). Cela étant, il convient également de tenir compte des précipitations qui ne cessent d’augmenter et qui risquent d’entraîner plus d’inondations et de coulées de boue. Le projet doit contribuer à ce que les destinations participantes développent leur modèle économique touristique afin qu’il soit viable à long terme.» On a analysé pour les trois destinations pilotes du canton des Grisons (Lenzerheide, Engadine Samnaun Val Müstair et Prättigau), comment le changement climatique les affecte et quels sont les risques et les opportunités prioritaires. Selon Martina Hollenstein, l’équipe du projet a élaboré avec les destinations concernées une feuille de route spécifique et accompagnera la première phase de mise en œuvre. Et Martina Hollenstein de souligner: «Ce n’est pas un sprint qu’il faut courir pour être prêt à faire face au climat, c’est un marathon. Nous considérons donc que notre rôle est d’initier un processus qui va bien au-delà de la fin du financement Innotour.» La capacité d’une destination à exploiter les opportunités qui se présentent à elle est également un facteur clé de sa réussite à long terme.

La Nouvelle politique régionale (NPR) soutient les projets de réorientation touristique
Mais un changement peut aussi être une chance: la Nouvelle politique régionale (NPR), financée par la Confédération et les cantons, offre aux destinations et aux entreprises de très nombreuses possibilités dans ce contexte. La NPR soutient par exemple des études de faisabilité pour des projets de réorientation touristique, comme pour le Fideriser Heuberge dans le Prättigau. Elle peut également soutenir la réorientation stratégique des chemins de fer de montagne, comme par exemple la Wiriehornbahnen AG. La NPR met en outre à disposition des fonds pour la planification de mesures concrètes visant à développer le tourisme estival, comme l’offre de VTT de la destination Engelberg-Titlis, ou pour des stratégies touristiques globales, comme à Kandersteg.
Le changement climatique pose de grands défis au tourisme en Suisse. Le SECO aide ce secteur à les relever grâce aux projets décrits ci-dessus, dont certains sont également présentés dans le dernier Insight, le magazine Innotour. Outre la promotion de projets, la politique du SECO en matière de tourisme vise également à soutenir l’adaptation au changement climatique, par exemple par le développement et le transfert de connaissances dans le cadre du «Forum Tourisme Suisse».
Innotour promeut l’innovation, la coopération et le développement des connaissances dans le domaine du tourisme suisse. Innotour concentre son soutien au niveau national. Cela signifie que la majorité des fonds sont utilisés pour des projets à vocation nationale et pour des tâches de coordination. L’instrument des projets modèles permet également de soutenir des projets au niveau régional et local.
Interreg offre aux régions la possibilité de se développer via des projets transfrontaliers concrets. L’UE, les pays limitrophes, les cantons, la Confédération et des privés financent la coopération dans de nombreux domaines. La participation suisse est financée dans le cadre de la Nouvelle politique régionale (NPR). Les fonds fédéraux proviennent du Fonds de développement régional et doivent être utilisés pour des projets qui contribuent à renforcer la compétitivité des régions. En revanche, les cantons peuvent également investir leurs fonds d’équivalence dans des projets qui ne servent pas directement à augmenter la valeur ajoutée ou à développer l’économie régionale.
Avec la Nouvelle politique régionale (NPR), la Confédération et les cantons soutiennent le développement économique des régions de montagne, des autres zones rurales et des régions frontalières. La NPR est entrée en 2024 dans sa troisième période pluriannuelle qui dure huit ans (2024-2031). Les anciens axes prioritaires «Industrie» et «Tourisme» sont maintenus. Les petites infrastructures peuvent désormais bénéficier de contributions à fonds perdu sous certaines conditions. Outre l’économie locale, qui complète l’orientation vers l’exportation de la NPR, le développement durable et la numérisation sont des thèmes transversaux qui revêtent une importance particulière.
Liens et sources
MétéoSuisse, 2024. Indicateurs climatiques.
NCCS, National Centre for Climate Services, 2024. CH 2018 – Scénarios climatiques pour la Suisse.
Suisse Tourisme, 2024, Tourisme d’hiver et réchauffement climatique.
Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB), 2024. Projet BeyondSnow.
Secrétariat d’Etat à l’économie SECO, 2024, Innotour – Projets soutenus.
Graubünden Ferien, 2024. Projet Klimafitte Destinationen, dernière consultation: 15.12.2024.
Littérature scientifique
Serquet, G., Rebetez, M. Relationship between tourism demand in the Swiss Alps and hot summer air temperatures associated with climate change. Climatic Change 108, 291–300 (2011). https://doi.org/10.1007/s10584-010-0012-6