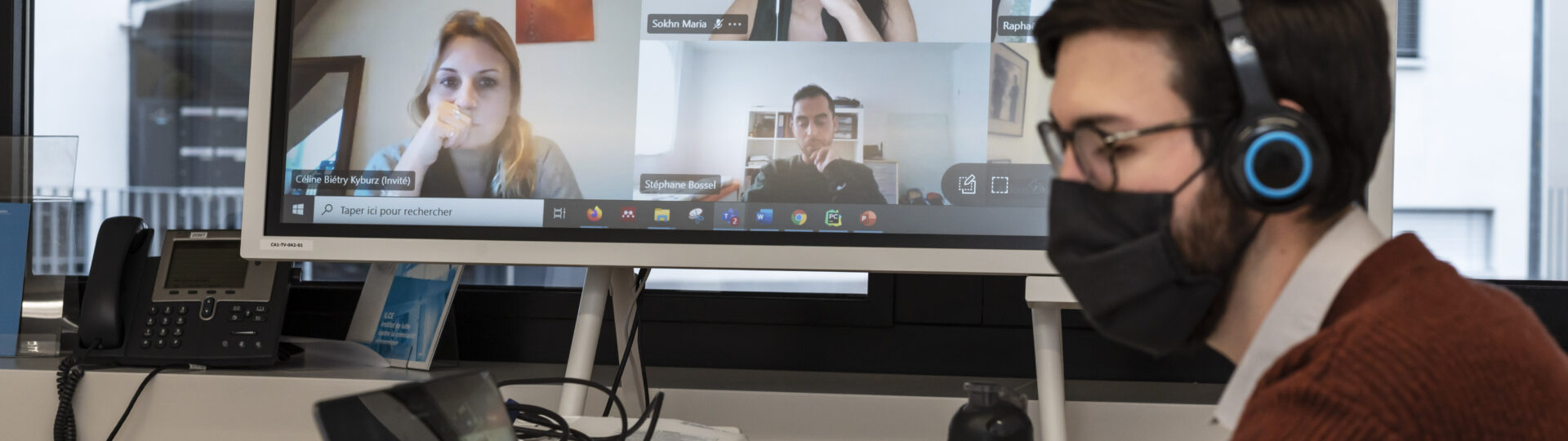De jeunes adultes développent des idées pour leur région au sein du Next Generation Lab de regiosuisse. On y teste aussi de nouvelles approches comme le «design thinking». Les premières expériences faites avec ce format sont prometteuses. Un bon accompagnement assuré par des coachs en innovation et des mentors qui connaissent bien la région est déterminant. Ce processus pourrait servir de générateur d’idées pour les régions. Des efforts supplémentaires sont toutefois nécessaires pour une mise en œuvre concrète des idées de projets.
Les orientations prises aujourd’hui modèlent l’avenir que vivra la prochaine génération. Mais comment associer de jeunes adultes à la planification du futur – des personnes de la génération Z nées au tournant du millénaire et faisant partie des «digital natives»? regiosuisse s’est fixé pour objectif d’associer activement des personnes de cette génération à la conférence «Suisse 2040: développement régional et territorial de demain – tendances, visions et domaines de développement», prévue à l’origine pour avril 2020. Un atelier dédié devrait offrir une plateforme aux jeunes adultes et à leurs idées lors de la conférence.
Rallier des jeunes pour l’avenir de la région
L’idée est séduisante. Mais comment enthousiasmer des jeunes pour une conférence spécialisée sur l’avenir du développement régional? Ce que de plusieurs organisateurs avaient pressenti s’est confirmé. «Il a été extrêmement difficile d’attirer de jeunes adultes avec ce thème, indique Thomas Probst, de regiosuisse, nous avons dû reconnaître que nous ne disposions en fait d’aucun accès aux jeunes.» Grâce à d’importants efforts ainsi qu’au soutien d’organismes de développement régional et de hautes écoles, ils ont finalement réussi à obtenir la participation de sept équipes à la conférence. Le coronavirus a toutefois causé du tort au projet.

En dépit de la pandémie, les initiateurs ont décidé de poursuivre le projet pilote de Next Generation Lab en 2020. Des équipes de trois ou quatre jeunes adultes devaient développer des idées de projets pour leur région dans le cadre d’un format innovant et créatif. L’approche du «design thinking» comprend des méthodes issues du management de l’innovation et du milieu des start-ups. Elle met l’accent sur les besoins et les motivations des usagers. Voici ses trois mots d’ordre: créativité, ouverture, multidisciplinarité. Quatre équipes (de la Region Prättigau/Davos, de Thurgovie, du Haut-Valais et du Bas-Valais) ont participé à la première journée, appelée «design sprint». Chaque équipe a été encadrée par un coach en innovation et par un-e mentor de sa région. Chacune s’est retrouvée sur place dans sa région. Les échanges avec les coachs et les mentors ont eu lieu virtuellement, de même que l’évaluation des idées de projets par un jury composé d’un représentant du SECO, d’une représentante de l’ARE et d’un représentant de regiosuisse.
Offre touristique et vente directe
Les résultats de la première journée ont été convaincants. Les quatre équipes auraient pu approfondir leurs idées lors d’une seconde journée dans le cadre d’un «deep dive». Mais des raisons personnelles comme le début de nouvelles formations et des changements de domicile ont eu pour conséquence que seules deux équipes ont poursuivi le travail. Celles-ci ont développé à cette occasion des modèles d’affaires et des plans de mise en œuvre. L’équipe du Bas-Valais a combiné son idée avec une offre touristique du val d’Hérens: elle prévoit de faire connaître aux visiteurs les beautés et les curiosités culturelles de la vallée à l’aide d’un tour en bus. Le groupe de Frauenfeld souhaite rapprocher les producteurs régionaux des consommateurs et vise ainsi la vente directe des produits en milieu urbain et la dynamisation des circuits courts.

«C’était exigeant, mais nous avons finalement obtenu un résultat», déclare Simon Vogel, du groupe de Frauenfeld. Il a beaucoup appris grâce au processus très professionnel. Ils ont réfléchi à ce qui est produit dans le canton. C’est ainsi qu’est née l’idée de créer en ville une offre de produits agricoles de la région – au-delà du marché hebdomadaire. «Nous voulons contribuer à façonner la région», explique Simon Vogel en esquissant la motivation des membres de son groupe. Professionnellement, il travaille comme assistant scientifique dans le domaine de l’électrotechnique auprès de la zhaw, Winterthour, et siège aussi au Grand Conseil du canton de Thurgovie depuis quelques mois.
Brigitte Fürer, directrice de Regio Frauenfeld jusqu’à cet été, a encadré le groupe lors de la première journée en qualité de mentor régional. «Regio Frauenfeld a toujours été ouverte aux projets menés avec des jeunes», indique-t-elle. Le développement régional et le développement durable vont de pair et concernent toujours aussi la jeune génération. Une initiative comme le Next Generation Lab donne de nouvelles impulsions et de l’inspiration. «Il incombe maintenant à la région de reprendre l’idée et de la développer», estime-t-elle.
Sherine Seppey a participé au Next Generation Lab avec deux collègues. Toutes trois ont choisi le val d’Hérens parce qu’elles connaissaient déjà la vallée. La première journée a été très productive. «L’encadrement nous a aidées à nous concentrer sur le cœur de notre idée », commente l’étudiante de la hes-so Valais. Lors de la deuxième journée, on a précisé l’idée et esquissé les étapes d’une réalisation. Elles ont trouvé un partenaire potentiel qui pourrait envisager d’intégrer leur proposition dans son offre touristique.
De l’idée à la mise en œuvre
L’idée de projet est réaliste, estime François Parvex, expert du développement communal et régional qui a encadré l’équipe Bas-Valais à Sion. «Les jeunes ont des idées, mais n’ont pas l’habitude de les mettre en œuvre dans le cadre d’un projet», explique-t-il. Ils ont vécu le Next Generation Lab comme un jeu formateur. Selon François Parvex, les responsables du développement régional pourraient utiliser ce format pour des concours d’idées. Il songe à une sorte de générateur d’idées pour les régions. Il faudrait ensuite mettre à disposition un capital financier de départ pour concrétiser et mettre en œuvre les idées.
Le membre du jury Maria-Pia Gennaio Franscini, coresponsable des «Projets-modèles pour un développement territorial durabl» auprès de l’Office fédéral du développement territorial (ARE), a en général affaire à des spécialistes. Elle était donc curieuse de voir comment s’organiserait la collaboration avec des jeunes. Voici sa conclusion: «Le degré d’engagement des participants a été impressionnant.» Elle pourrait aussi envisager à l’avenir d’intégrer activement les jeunes et les expériences faites avec différentes méthodes et approches dans les projets-modèles pour un développement territorial durable.

«Le Next Generation Lab est un très bon levier pour sensibiliser les jeunes au développement de leur région», juge Sherine Seppey. On ignore encore quelle suite sera donnée à l’idée développée par son groupe. Cela dépend de ce que l’on attend de la jeune génération, conclut Simon Vogel, du groupe de Frauenfeld. «La génération d’idées fonctionne bien.» Mais leur mise en œuvre avec des jeunes est peu réaliste, car ceux-ci sont encore en formation ou très engagés dans d’autres domaines. Il sera peut-être possible de réaliser une idée dans le cadre d’une initiative existante. Simon Vogel est convaincu que leur «idée irait très bien avec un concept de possible reconversion de la caserne de Frauenfeld». Judith Janker, directrice de Regio Frauenfeld depuis septembre, souhaite elle aussi poursuivre le développement de cette idée. Le thème choisi répond à l’esprit du temps. L’idée aurait dû être présentée fin octobre lors du 25e anniversaire de Regio Frauenfeld. Mais il a fallu reporter cette fête au printemps prochain à cause de la situation sanitaire.
«Tant à Frauenfeld que dans le Bas-Valais, les équipes ont développé des modèles d’affaires concrets en deux jours. Elles ont ainsi atteint un stade nettement plus avancé que celui auquel nous nous attendions lors de la conception du Next Generation Lab», commente Thomas Probst, membre des initiateurs. Il s’agit maintenant d’examiner comment les plans peuvent aboutir à une mise en œuvre, ce qui requiert l’intervention non seulement des jeunes adultes, mais aussi des acteurs expérimentés des régions.
Next Generation Lab: Design your future!
Dans un laboratoire, nous développons de nouvelles idées et les testons. De nouveaux procédés sont expérimentés pour continuer de développer certaines idées ou en rejeter d’autres. Grâce à la créativité et au travail d’équipe, les idées retenues sont améliorées. C’est exactement comme cela que fonctionne le Next Generatio Lab – un laboratoire d’innovation pour développer des idées. Ici, regiosuisse teste une approche de co-création dans l’espace virtuel: regiosuisse.ch/fr/next-generation-lab